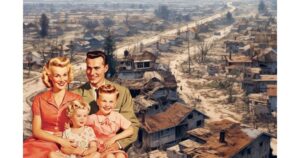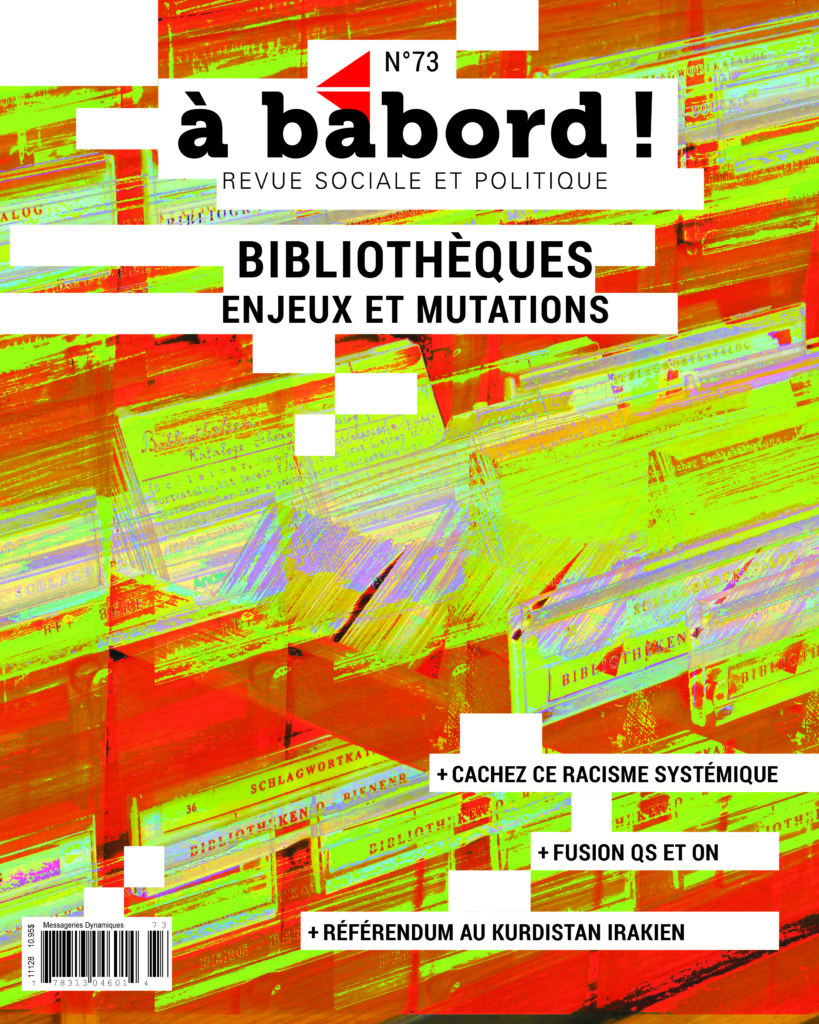Ce texte a été publié dans le no 23 (Hiver 2020) des Nouveaux cahiers du socialisme. Il fait partie d'un dossier intitulé La droite : quelles droites ?.
La présence de l’extrême droite en ligne semble de plus en plus importante. Si on peut se surprendre de l’efficacité de la diffusion contemporaine des idées de l’extrême droite sur Internet, cette diffusion relève pourtant de stratégies de propagande qui ont été mises en place graduellement au fil des progrès technologiques. De plus, la « culture Internet » semble avoir contribué significativement à accroître la visibilité de l’extrême droite en ligne. Cette culture, à la fois modelée par les utopies futuristes d’un cyberespace libertaire et par une sous-culture élitiste du trolling, s’est avérée un terreau fertile pour la droite radicale. Son influence est restée sous le radar médiatique jusqu’à ce que la victoire de Trump mette à l’avant-plan l’« alt-right » qui doit l’essentiel de son influence à la dynamique d’Internet et des médias sociaux et à laquelle on attribue parfois la victoire électorale de Trump.
Dès les origines d'Internet
Si le « réseau des réseaux » émerge graduellement dès le début des années 1970, son utilisation par le public est alors très marginale. On commence néanmoins dès l’origine à imaginer comment Internet allait devenir un lieu de partage du savoir et de liberté d’expression favorable à la mixité culturelle et à la tolérance… Or, avant même qu’Internet devienne publiquement accessible dans les années 1990, un premier BBS (bulletin board system) néonazi, Liberty net, voit le jour. À la même époque, on trouve aussi des initiatives du même genre en Allemagne où des militants utilisent déjà des fichiers cryptés pour se protéger d’éventuelles fouilles policières. L’essai Résistance sans leader publié en 1983 par Louis Beam, promoteur américain de la suprématie blanche, popularise ainsi une stratégie de « résistance » décentralisée et difficile à freiner par les forces de l’ordre. Cette stratégie appelle aussi à la diffusion de matériel de propagande à la suite de différentes actions d’éclat comme des attentats. On verra l’influence de Louis Beam jusque dans le long manifeste de 2011 du terroriste norvégien Anders Breivik, 2083 : A European Declaration of Independence, diffusé après les attentats où il appelle les « mouvements de résistance » blancs à créer des sites Web et des pages Facebook. La popularisation de l’accès à Internet au milieu des années 1990 allait cependant déjà permettre de diffuser la propagande d’extrême droite à un niveau que ne permettaient pas d’atteindre les moyens traditionnels du tractage, des journaux, de la radio ou de la télé.
Les premiers groupes de discussion Usenet, un système décentralisé, se développent dans les années 1980 et 1990 et furent le principal lieu d’échange des premières générations d’internautes, ce qui en fera un lieu de propagande privilégié. Usenet fut aussi l’incubateur de la culture des trolls, qui cherchent à déclencher des débats houleux pour le simple plaisir de voir la discussion s’envenimer ou pour rebuter les nouveaux venu·e·s. Cette « culture troll » s’est développée dans plusieurs lieux d’échange plus récents et a construit des ponts avec l’extrême droite sur Internet, car comme les trolls, cette dernière utilise abondamment l’ironie ainsi que des codes « humoristiques » qui donnent le sentiment de faire partie d’une communauté.
Comme Usenet est le plus populaire lieu commun d’échange sur Internet, les groupes de discussion d’extrême droite s’y multiplient. Faciles d’accès, ils sont fréquentés par des militants et militantes en quête d’influence. C’est le cas notamment de Don Black, un ancien du Ku Klux Klan, qui lance en 1996 le premier site Web néonazi Stormfront, ou de Marc Lemire, créateur du BBS canadien Digital Freedom. Engagé dans une saga judiciaire, Lemire réussira plus tard à faire invalider par la Cour suprême canadienne une partie d’une loi limitant la liberté d’expression de l’extrême droite en ligne. Des appels pour rendre difficile l’accès aux groupes de discussion d’extrême droite sont rapidement dénoncés comme de la censure, d’autant plus qu’Internet est perçu à ses débuts comme un monde autonome hors des réglementations étatiques.
Le Web de la haine
Internet se transforme rapidement au cours des années 1990 à la faveur de modifications réglementaires permettant la création de fournisseurs de service Internet, lesquels élargissent l’accès au réseau par le grand public, mais aussi l’accès aux forums Usenet qui deviennent des instruments de propagande d’une redoutable efficacité. De son côté, la création du Web a facilité l’accès aux ressources disponibles sur le Net en simplifiant entre autres la création de sites Web par toute personne ayant quelques connaissances informatiques. L’extrême droite ne ratera pas l’occasion. Le plus célèbre des sites de cette mouvance est Stormfront mis en ligne en 1996 – et toujours en ligne – par le suprémaciste blanc Don Black. Le Sourthen Poverty Law Center considère aujourd’hui le site de Black comme la « capitale virtuelle des meurtriers nationalistes blancs », plus d’une centaine de meurtres ayant été commis par certains de ses habitués.
Le Web naissant ne servira pas qu’à la discussion : certains militants élaborent des pages personnelles et diffusent leurs propres écrits et collectionnent les liens vers des sites racistes. D’autres mettront en place des boutiques de musique en ligne qui serviront à tisser des liens entre groupes extrémistes à travers le monde. Les partis d’extrême droite ne sont pas longs à profiter d’un tel espace. Au Royaume-Uni, le parti ultranationaliste British National Party fonde dès le début du Web un site qui, encore aujourd’hui, est l’un des plus visités en comparaison de ceux des autres partis. En France, le Front national est le premier parti à disposer d’un site Web en 1996. Aux États-Unis, on comptait, dès la fin de la décennie 1990, plus de 2000 sites d’extrême droite de tout genre. Leur influence grandissante croît notamment avec la crédibilité que leur donne l’usage des mêmes logiciels que ceux d’autres sites respectés.
Blogues et agrégateurs
Au tournant des années 2000, les forums Web remplacent graduellement Usenet alors que les blogues se popularisent au point de devenir pour certains une source de revenus. Les médias traditionnels s’approprient ces nouveaux formats de publication Web et commencent à embaucher des « animateurs de communauté ». En 2003, grâce aux stratégies médiatiques d’un tel animateur, Stormfront voit son audience passer en une décennie de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers. Des sites « agrégateurs » qui regroupent les publications de plusieurs autres sites facilitent la recherche puisque plusieurs publications et blogues au contenu similaire apparaissent sur une seule page. C'est le cas de breibart.com, à son origine un simple agrégateur de nouvelles conservatrices. Son influence est devenue telle qu'il fournit le premier conseiller en chef de Donald Trump. En France, le site fdesouche.fr connaît un succès semblable en proposant une sélection biaisée de nouvelles servant les propos de l'extrême droite. Se présentant comme une « agence de presse », le site Novopress (novopress.info) fondé à l’initiative du parti Les Identitaires prétend faire de la « réinformation ».
C’est aussi pendant cette période que se perfectionnent les boutiques en ligne. En 2005, un jeune diplômé danois fonde la maison d’édition Integral Tradition Publishing qui deviendra plus tard Arktos. Cette petite maison d’édition utilise habilement à la fois la diffusion numérique et imprimée de ses livres. La version électronique de ses ouvrages est maintenant aussi disponible sur le distributeur Amazon, ce qui leur donne une visibilité accrue. Elle publie notamment les écrits de Julius Evola, un auteur important de la pensée « traditionaliste ésotérique », ainsi que des auteurs de la nouvelle droite européenne comme Alain de Benoist. L’influence d’Arktos grandira au point d’être maintenant considérée comme un point de rencontre important entre l’alt-right américain, le nationalisme russe et la nouvelle droite européenne. Ses idées ont maintenant un impact dans les hautes sphères des puissances politiques internationales. En effet, la maison d’édition publie le traditionaliste russe Alexander Dugin, un conseiller du président russe Vladimir Poutine. Les idées de Julius Evola diffusées par Arktos auraient aussi influencé Steve Bannon, l’ancien conseiller de Trump.
Médias sociaux et expansion de la fachosphère
À la fin des années 2000, les blogues personnels et les forums Web ont progressivement été remplacés par les « médias sociaux », qui peuvent être considérés comme des sites combinant la publication de blogues simples et l’agrégation de ce qui est publié. De savantes stratégies de promotion et de fidélisation ont propulsé la popularité des médias sociaux commerciaux comme Facebook et Twitter, ou leurs équivalents ailleurs dans le monde, au point où ils sont maintenant la source d’information principale de la majorité des utilisateurs et utilisatrices de Facebook et de Twitter. Ces stratégies et choix algorithmiques ont outillé les groupes d’extrême droite pour rejoindre encore davantage de publics et pour développer de nouvelles stratégies de promotion. Par exemple, les algorithmes de recommandations de YouTube ont déjà été identifiés comme vecteurs de propagation des discours d’extrême droite. En clair, tout usager ou usagère du site qui était déjà intéressé à des contenus libertariens ou conservateurs s’est vu suggérer le visionnement de vidéos faisant la promotion de la suprématie blanche ou de nationalistes extrémistes.
En Amérique, l’épisode du gamergate est souvent considéré comme le point de départ d’une nouvelle dynamique. Le gamergate est une vaste campagne décentralisée contre l’influence du féminisme (et plus largement des « social justice warriors ») dans le monde du jeu vidéo. Les menaces visant des femmes journalistes furent nombreuses et violentes, passant souvent par la plateforme Twitter. Cela pourrait laisser penser que Twitter a joué un rôle central, mais en fait le gamergate a contribué à révéler une dynamique redoutable décuplant l’influence de l’extrême droite et lui permettant de recruter dans les rangs antiféministes et masculinistes. Ainsi les médias sociaux populaires ont servi de mégaphone et de terrain à des actions lancées à partir de forums moins connus tels 8chan, 4chan, Reddit, IRC, etc. Ces campagnes de harcèlement se déroulaient cependant sur des plateformes plus populaires comme Twitter, ce qui leur a donné un impact beaucoup plus grand que si elles s’étaient limitées aux utilisateurs et utilisatrices des plateformes plus marginales où elles étaient mises en place.
Le gamergate a profité à l’extrême droite américaine qui a su utiliser le potentiel de recrutement créé par une controverse ayant comme motivation centrale une aversion contre le « politiquement correct » et le féminisme. Le site Breitbart a embauché Milo Yiannopoulos comme chroniqueur techno pour rédiger de nombreux articles attisant la haine. C’est dans un article dont Yiannopoulos est coauteur que le terme alt-right a été popularisé et redéfini pour désigner ce mouvement de droite dont les frontières se limitaient encore à Internet avant l’élection de 2016. Nébuleuse critique du politiquement correct, antiféministe, anti-immigration et adepte du trolling, on tentait de dissocier l’alt-right de la droite radicale et violente, mais il fut récemment révélé qu’Yiannopoulos consultait secrètement des néonazis notoires pour la rédaction d’articles.
À cet effet, le ralliement Unite the Right à Charlottesville en août 2017, pendant lequel une contre-manifestante a été tuée, visait à rendre active l’alt-right en dehors d’Internet. Le caractère outrageant des réactions de l’extrême droite à cet événement tragique aura au moins révélé qu’en dépit de ce qu’elle prétend, l’alt-right compte en son sein des néonazis influents comme Richard Bertrand Spencer
Liberté d'expression
La liberté d’expression sur Internet est un sujet de débat depuis des décennies. Il peut sembler surprenant que des sites ouvertement néonazis aient pu être accessibles publiquement pendant d’aussi longues périodes. Une partie du succès de la propagande d’extrême droite est que sa présence en ligne n’est pas secrète. Pour preuve, on peut facilement accéder aux discussions, textes, vidéos, baladodiffusions et autres sur des sites Web publics ou des plateformes bien connues comme Twitter, YouTube, 4chan, 8chan, etc. C’est la conception américaine de la liberté d’expression qui s’applique à beaucoup de ces sites, c’est-à-dire que tout discours qui ne contient pas d’appel explicite à la violence est toléré. Dans les cas où les propos tenus sur un site européen pourraient causer des problèmes, on met le site juridiquement à l’abri en l’hébergeant sur des serveurs américains. L’anonymat est une autre stratégie de protection. En effet, le sentiment de ne pas être identifiable incite à tenir des propos plus outrageants. Il est possible d’observer cette stratégie sur certains forums publics comme 4chan et 8chan, ou le groupe Blabla 18-25 ans du forum francophone jeuxvideo.com. Ce groupe de discussion a d’ailleurs été infiltré par le Front national en 2012 pour y diffuser ses idées.
Certaines discussions sont cependant gardées secrètes. Dans ce cas, on utilise des groupes fermés, ce qui permet de limiter l’accès aux discussions à des personnes de confiance, ou on utilise des plateformes moins connues, mais tout de même assez fréquentées comme Discord, destinées principalement aux discussions entre adeptes de jeux vidéo. Cette plateforme est régulièrement utilisée comme lieu de communication privé en temps réel par les habitué·e·s de certains forums publics de Reddit, 4chan, ou d’autres. Gabriel Sohier Chaput, un Montréalais contributeur régulier du site néonazi Daily Stormer utilisant le pseudonyme Zeiger, s’est servi de Discord pour recruter et organiser à Montréal des rencontres de militants et militantes d’extrême droite. La plateforme Discord a aussi été utilisée pour organiser le ralliement de Chalottesville ou pour préparer d’autres actions coordonnées visant à intimider des journalistes ou d’autres cibles.
Le débat sur la liberté d’expression en ligne n’est pas clos. La censure des propos haineux et de la manipulation de l’information sur les réseaux sociaux est limitée du fait que les réseaux sociaux les plus populaires sont la propriété d’entreprises privées qui, tout en cherchant à se dissocier des discours de l’extrême droite, profitent de l’engouement pour ceux-ci. Par ailleurs, la censure s’avère souvent inefficace : l’exil numérique permet en effet à certains groupes de se reformer sur d’autres plateformes moins connues ou même sur de nouvelles plateformes. Par exemple, Gab est un réseau social alternatif créé en dénonciation d’un biais anti-conservateur de Facebook et du « monopole » qu’aurait la gauche sur les médias sociaux. Gab est devenu assez populaire pour avoir attiré le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro qui y a maintenant un compte officiel lui permettant de conserver un lien avec des groupes de ses supporters bannis de Facebook.
Conclusion
L’influence de l’extrême droite sur Internet et les médias sociaux risque de s’accroître et de se transformer encore dans un avenir rapproché. Il importe donc d’en tenir compte pour comprendre la dynamique de cette mouvance politique puisque de nombreux groupes échappent notamment aux partis politiques. Le plus troublant est de constater que des groupuscules usant des mêmes stratégies (décentralisées) que celles utilisées par la gauche militante ont finalement un impact plus grand en termes de rayonnement et d’influence. Plusieurs facteurs peuvent sans doute expliquer cette situation paradoxale. Premièrement, on ne peut pas attribuer la montée de l’extrême droite uniquement à son utilisation d’Internet comme moyen de propagande. La causalité est possiblement inverse : la présence des discours d’extrême droite en ligne est un effet de la montée généralisée de son idéologie dans la société et de sa présence accrue dans les médias traditionnels. Ensuite, la gauche n’a probablement pas su utiliser Internet comme outil de militantisme comme l’extrême droite a pu le faire parce qu’elle ne s’est pas suffisamment intéressée aux nouveaux médias et que les stratégies décentralisées associées à Internet n’ont pas été suffisamment comprises ou mises à profit. La culture des trolls, considérée par certains comme la raison principale de l’impact de l’alt-right, a pu être plus facilement récupérée par l’extrême droite que par la gauche, mais elle est peut-être aussi amplifiée par le virage sensationnaliste des médias traditionnels. Enfin, la nature même des objectifs de la gauche et de l’extrême droite peut expliquer le succès de cette dernière. De fait, il est beaucoup plus facile de diffuser une idéologie visant la division, la domination ou carrément la haine que de diffuser des idées de construction collective d’une meilleure société pour toutes et tous.